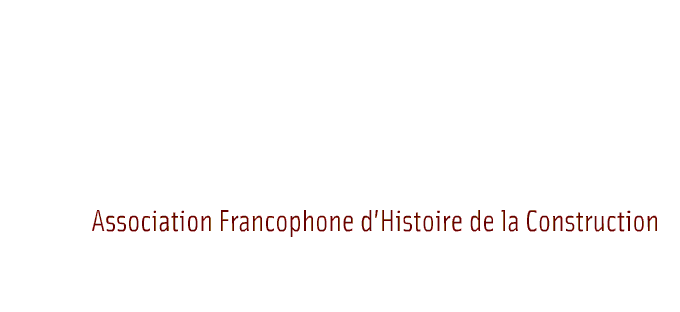Aedificare 2024-1, no 15
Ædificare est une revue semestrielle, internationale, multilingue et pluridisciplinaire couvrant le champ historique de la construction, toutes périodes et aires géographiques confondues. La revue dispose d’un Comité scientifique et d’un Comité de lecture internationaux. Tous les articles font l’objet d’une évaluation par les pairs en double aveugle. Elle paraît en publication papier et numérique aux éditions Classiques Garnier.
Sommaire
Robert Carvais, Valérie Nègre – Éditorial. Observer la cille comme la campagne – André Guillerme (1945-2024) – Editorial Observing city and country–André Guillerme (1945–2024)
DOSSIER
ÉPURES D’HISTOIRE : UN PROCESSUS PRAGMATIQUE, EN HOMMAGE À JOËL SAKAROVITCH (1949-2014) / ÉPURES D’HISTOIRE: A PRAGMATIC PROCESS IN HONOUR OF JOËL SAKAROVITCH (1949–2014)
Antonio Becchi, Robert Carvais, Pascal Dubourg Glatigny, Épures d’histoire. Un processus pragmatique en hommage à Joël Sakarovitch (1949-2014)
Ce dossier rend hommage à l’héritage intellectuel de Joël Sakarovitch (1949-2014), au croisement de multiples disciplines contribuant à la compréhension historique du bâti et de l’architecture. Il regroupe des contributions qui interrogent les oppositions et la complémentarité de l’histoire de l’architecture et de la construction, dans la perspective de faire émerger de nouveaux objets de recherche.
Hélène Rousteau-Chambon, Charles-Étienne-Louis Camus (1699-1768), un lien entre l’Académie royale d’architecture et l’Académie royale des sciences ?
De 1730 à 1748, Charles-Étienne-Louis Camus mena une carrière exemplaire au sein de l’Académie royale des sciences et de l’Académie royale d’architecture. Camus essaie-t-il d’établir un « pont » entre ces deux institutions, comme l’avait fait La Hire, ou mène-t-il des activités clairement distinctes ? L’étude des mémoires présentés par Camus dans les deux institutions permet de comprendre le contenu de ses discours et de conclure sur ce sujet.
Dominique Raynaud, Les constructions géométriques Une tradition autonome entre géométrie pratique et géométrie savante ?
Contrairement au présupposé courant que les constructions géométriques sont la solution de problèmes pratiques au moyen de la géométrie savante, les documents historiques montrent qu’elles occupent une position autonome entre géométrie savante et géométrie pratique. Cette position est objectivée en termes de méthododiversité, de diffusion, et de minimum de Hartshorne, dans le cas des constructions géométriques utilisées pour trouver le centre perdu d’un cercle.
Werner Oechslin, « La construction est une science ; c’est aussi un art. » Zur Erinnerung an Joël Sakarovitch
La définition de construction comme science donné par Viollet-le-Duc est ambigüe. L’association au « faire », à « l’édification » et à la mécanique, est évident, mais depuis Vitruve à la “fabrica” est associé la “ratiocinatio”. Ce rapport laisse ouvert multiples interprétations. La construction sert bien aussi à l’explication de faits linguistiques et philosophiques, il faut donc analyser de plus près la multitude des emplois de ce mot pour mieux comprendre le sens – et les sens.
Roberto Gargiani, Mechanical Architecture per il Real Estate del capitalismo americano del XIX secolo Il contributo di Whitney, Strobel, Shankland e Purdy alla Skeleton Construction di Chicago
L’architecture de l’époque contemporaine a connu un début décisif pour la formulation des critères de sa production, dans le système économique et professionnel américain. C’est dans ce contexte, où toute pratique a explosé, que l’architecture est devenue « mécanique » et a donc connu l’émergence d’une figure professionnelle capable de dominer le système de fabrication et d’assemblage des composants industriels, élaborés pour correspondre au cadre financier du naissant marché immobilier.
Guy Lambert, Travaux d’élèves et exercices scolaires dans l’histoire des formations à l’art de bâtir Retour sur la construction d’un objet d’étude
Cet article propose de relire un texte publié par Bruno Belhoste, Antoine Picon et Joël Sakarovitch en 1990, et l’examine en conjuguant démarche historiographique et mise en lumière d’un enjeu épistémologique (l’histoire des travaux d’élèves dans les formations à l’art de bâtir), à la croisée des champs disciplinaires (histoire de l’art et de l’architecture, histoire des sciences et des techniques, histoire de l’éducation et sciences de l’éducation).
Bill Addis, Following the traces of structural engineer-designers
Cet article traite des traces que les ingénieurs-concepteurs laissent derrière eux et que les historiens de l’ingénierie peuvent étudier. Parmi les nombreux types de sources, les plus révélatrices ont peut-être été les diverses enquêtes publiques visant à déterminer les causes des échecs de l’ingénierie lorsque le travail des ingénieurs a été soumis à des esprits juridiques inquisiteurs. L’article examine dans quelle mesure ces sources d’information révèlent le travail de l’ingénieur-concepteur.
Olga Medvedkova, Histoire de l’architecture ou histoire de la construction ? Le livre d’architecture comme source et méthode
Quels types de sources devons-nous rechercher si nous voulons faire de l’histoire de l’architecture une authentique science humaine ? Il s’agit, dans cet article, de rappeler l’importance parmi ces sources du livre d’architecture. En parcourant l’histoire de ses études dans l’historiographie anglo-saxonne, l’auteur suit son évolution vers la prise en compte de ce livre en tant qu’objet matériel.
Jean Dhombres, Hommage à Joël Sakarovitch Une pensée de ou dans la figure
En intitulant l’hommage à Joël Sakarovitch – Une pensée de ou dans la figure -, je tiens à montrer comment ses livres, ses travaux, ses exposés, peuvent encore inspirer tous ceux qui réfléchissent sur les liens entretenus au cours de l’histoire entre la construction architecturale, la représentation des objets mathématiques, et les différentes formes de calcul.
François Fleury, Rémy Mouterde, Interdisciplinarité et synergies entre recherche et enseignement en histoire de la construction L’enseignement de Joël Sakarovitch
Cette communication se propose de partager ce que nous avons pu apprendre au contact de Joël Sakarovitch en matière de méthodologie, d’enseignement, de posture scientifique. Elle tente de mettre en lumière la portée d’un mode de constitution des savoirs en histoire de la construction qui s’appuie sur l’archéologie expérimentale en rassemblant étudiants, chercheurs et praticiens, sans exclusive disciplinaire.
Enrique Rabasa Díaz, El futuro que tuvo la Geometría descriptiva Algunos debates derivados de las ideas de Monge
Cet article examine certains des débats suscités par les idées de Gaspard Monge, en particulier en ce qui concerne la perspective conique et l’axonométrie. Certains des arguments de ces débats apparaîtront dans des contextes très différents. En ce qui concerne la stéréotomie, Monge a appliqué sa théorie des lignes de courbure au dessin de l’appareil de la voûte ellipsoïdale surbaissée, qui, en raison de sa complexité, n’a jamais été exécutée. L’article montre que cette idée a finalement été réalisée aujourd’hui.
VARIA
Antonio Becchi, Robert Carvais, Pascal Dubourg Glatigny, Luc Tamborero, La forma mentis de Joël Sakarovitch La tolérance de l’efficacité, d’après une interview de son élève et collaborateur Luc Tamborero, compagnon du devoir tailleur de pierre
Dans une interview menée à trois voix, Luc Tamborero nous dévoile son parcours depuis son enfance, sa formation de compagnon du devoir tailleur de pierre et sa rencontre avec Joël Sakarovitch qui lui fait découvrir la stéréotomie académique, les archives historiques et les échanges intellectuels. De la lecture des épures aux expérimentations, en passant par la réalisation de son chef-d’œuvre, il nous expose sa passion de chercheur qui le mène à envisager une thèse sur Jules-Hardouin Mansart.
Patricia Radelet-de Grave, La caténaire avant la naissance du calcul Quelques réflexions en hommage à Joël Sakarovitch
Le problème de la caténaire est, dès son origine et de nos jours encore, d’une importance capitale dans le domaine de la construction. L’article donne un aperçu de la préhistoire des caténaires et des courbes similaires, de la palette de Narmer à l’architecture contemporaine, mais avant l’avènement du calcul différentiel introduit par Leibniz et Huygens. Les principaux auteurs sondés sont Philibert Delorme, Isaac Beeckman, Galileo Galilei, Gaston Pardies et Leonhard Euler.