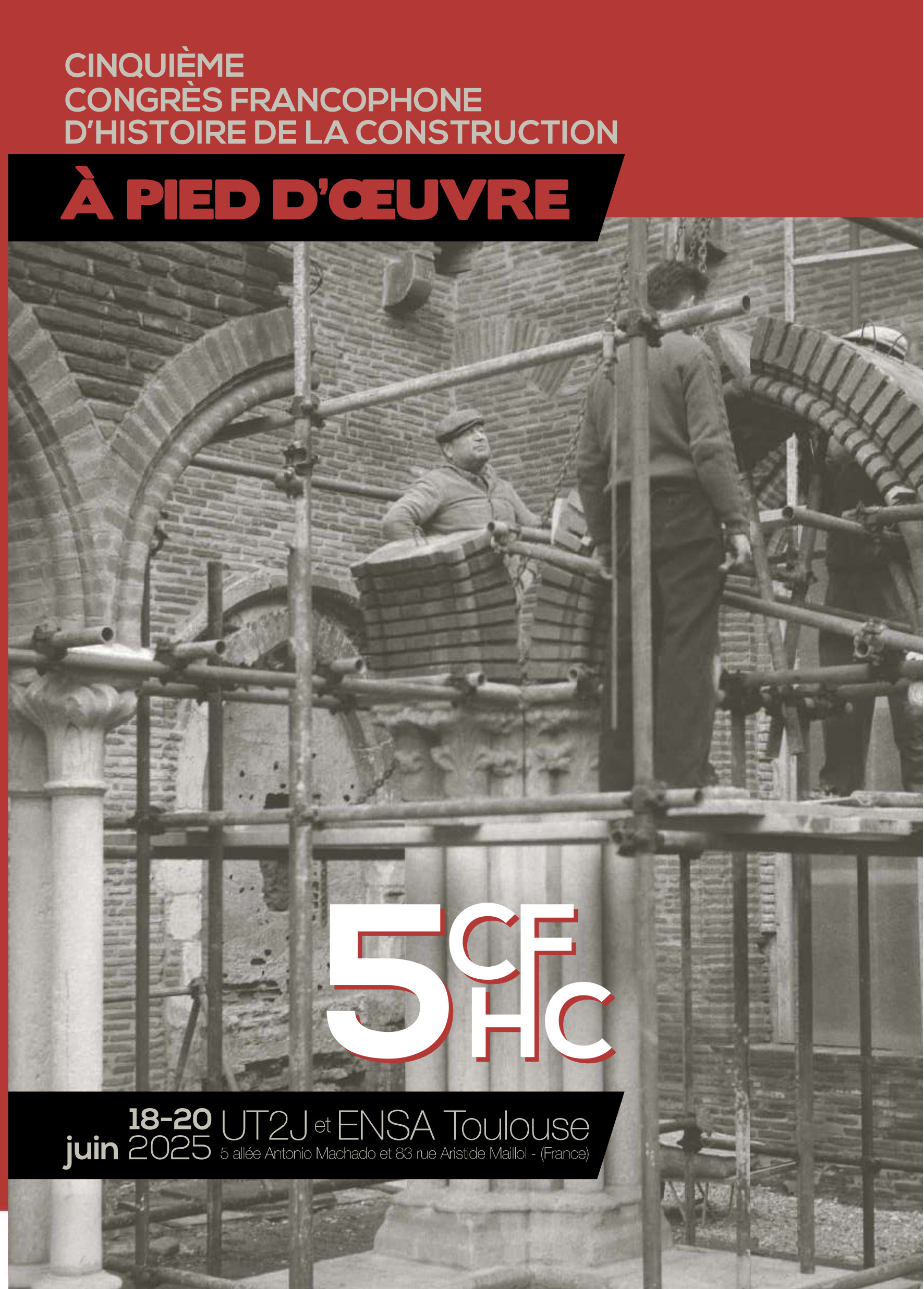Séminaire Histoire de la construction
Organisé par
Le Centre de théorie et analyse du droit
(CTAD) UMR 7074, CNRS – Université Paris Nanterre
Le Laboratoire Archéologie et Philologie
d’Orient et d’Occident (UMR 8546, ENS-CNRS-EPHE)
Le laboratoire Orient & Méditerranée. Textes
Archéologie Histoire (UMR 8167, CNRS-Sorbonne Université-
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
et
L’Université de Lausanne
Mardi 8 avril 2025
de 9h30 à 16h30
Les escaliers
Lieu :
UNIL – Université de Lausanne (Suisse),
Amphipôle, salle 340.1
Métro : Sorge
9h30 Introduction par Hélène Dessales (UNIL, ENS)
10h Thomas Hufschmid, Responsable du secteur Restauration des monuments, Augusta Raurica
Les escaliers dans l’architecture romaine : l’exemple d’Augusta Raurica (CH)
11h Matthieu Demierre, UNIL
Mines, caves et remparts : quelques attestations d’escaliers protohistoriques européens
12h-14h Déjeuner
14h Raphaël Vouilloz, doctorant ENSA Grenoble, MHA
L’escalier en fer-à-cheval de Fontainebleau : étude géométrique et transposition numérique
15h Edoardo Piccoli, Politecnico di Torino
Des ascensions fragiles. Escaliers italiens en porte-à-faux en marbre entre XIXe et XXe siècle
16h Revue de publications récentes sur l’histoire de la construction
Résumés
Thomas Hufschmid, docteur en sciences historiques, est responsable de la conservation et de l’étude des monuments architecturaux de la ville romaine d’Augusta Raurica. Il a suivi des études de préhistoire et de protohistoire, d’archéologie romaine provinciale, d’archéologie classique et d’égyptologie à l’Université de Bâle et a soutenu sa thèse de doctorat en 2007 à Bâle sur le thème des amphithéâtres antiques en Italie et dans les provinces romaines. Après un stage d’études à Rome en 1999, il a participé au projet de restauration du théâtre romain d’Augst, qui a duré 16 ans, en tant qu’archéologue et responsable de chantier du théâtre. De 2012 à 2020, il a occupé le poste de responsable des monuments au Site et Musée Romains d’Avenches. Depuis plus de 35 ans, il travaille comme collaborateur scientifique à Augusta Raurica. Il est Fellow de la Society of Antiquaries of London et intervient souvent dans des conférences en Suisse et à l’étranger. Il est expert international en architecture antique et en restauration des monuments romains et enseigne régulièrement aux universités de Lausanne et de Bâle. Ses recherches portent principalement sur : l’architecture antique, en particulier l’architecture et les techniques de construction romaines ; les monuments de spectacle romains et leurs jeux ; l’architecture privée de l’époque impériale romaine dans les provinces du nord ; l’histoire de la recherche et de la réception de l’archéologie romaine au nord des Alpes ; la restauration/conservation des monuments antiques (aspects techniques et conceptuels).
Les escaliers dans l’architecture romaine : l’exemple d’Augusta Raurica (CH)
Les escaliers constituent un élément essentiel dans l’architecture romaine et répondent à de multiples
fonctions. Au plus simple, ils constituent un moyen de communication physique dans un bâtiment à plusieurs étages. Par ailleurs, les escaliers représentent également des éléments structurants dans des ensembles architecturaux ou ils soutiennent l’organisation topographique et urbanistique dans des villes ou des agglomérations entières. Le cas de la ville provinciale romaine d’Augusta Raurica permet de montrer quelles formes d’escaliers et de constructions semblables à des escaliers se retrouvent dans l’architecture romaine, quelle est leur importance dans le système architectural et comment leur réalisation a été effectuée. Quelles sont les règles et les particularités de leur construction, qu’est-ce qui a déterminé le choix des matériaux et comment peut-on reconnaître les volées d’escalier qui existaient autrefois dans les vestiges archéologiques, même si les escaliers eux-mêmes ont disparu ? La gamme des découvertes présentées englobe les escaliers de communication dans les maisons privées, les escaliers représentatifs dans les espaces publics et même les gradins des monuments de spectacles antiques.
Bibliographie sélective :
Th. Hufschmid (mit Beiträgen von Ph. Rentzel, N. Frésard und M. E. Fuchs), Amphitheatrum in Provincia et
Italia. Architektur und Nutzung römischer Amphitheater von Augusta Raurica bis Puteoli. Forschungen in
Augst 43 (Augst 2009).
Th. Hufschmid/L. Tissot-Jordan, Amphorenträger im Treppenhaus – Zur Architektur und Wanddekoration der Gebäude in Insula 39 von Augusta Raurica
Th. Hufschmid/B. Pfäffli (Hrsg.), Wiederentdeckt! Basilius Amerbach erforscht das Theater von Augusta
Raurica. Beiträge zu dem zwischen 1588 und 1591 entstandenen Manuskript O IV 11 in der Universitätsbibliothek Basel. Publikationen der Universitätsbibliothek Basel 42 (Basel 2015).
Th. Hufschmid; (Red.), Theaterbauten als Teil monumentaler Heiligtümer in den nordwestlichen Provinzen des Imperium Romanum: Architektur – Organisation – Nutzung. Internationales Kolloquium in Augusta
Raurica, 18.-21. September 2013, Auditorium Römerstiftung Dr. René Clavel, Augst-Kastelen. Forschungen in Augst 50 (Augst 2016).
Th. Hufschmid/I. Horisberger-Matter, Ines; «Ipsius autem theatri conformatio sic est facienda …» 16 Jahre
Forschung und Restaurierung im römischen Theater von Augst. Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst 29, 2008, 161-225.
Th. Hufschmid/M. Aberson; Bâtiments publics inachevés: crises et solutions. In: M. Cébeillac-Gervasoni/L. Lamoine/C. Berrendonner (Hrsg.), Gérer les territoires, les patrimoines et les crises. Le quotidien municipal
II (Clermont Ferrand 2012) 247-260.
Th. Hufschmid, Provinzial statt provinziell. Architekturkonzepte und Baudekor in Aventicum/Avenches (CH), der Hauptstadt der Helvetier. In: J. Lipps (Hrsg.);Transfer und Transformation römischer Architektur in den Nordwestprovinzen. Kolloquium vom 6.-7. November 2015 in Tübingen (Rahden/Westf. 2017) 175-194.
Th. Hufschmid, Theatres, amphitheatres and spectacles in the north of the Roman Empire. The example of
the antique monuments in Roman Switzerland. In: Storchi, Paolo; Mete, Gianluca (a cura di) con la collaborazione di Badodi, Eleonora; Giochi e spettacoli nel mondo antico, problematiche e nuove scoperte. Atti del Convegno Internazionale, 24 Marzo 2018 a Reggio Emilia (Roma 2019) 161-175.
Th. Hufschmid, Provincial-sized monumentality: The construction site of the Roman theatre of Augusta Raurica (Switzerland). In: N. Mugnai (ed.); Architectures of the Roman World. Models, Agency, Reception (Oxford & Philadelphia 2023) 101-122.
Th. Hufschmid, Die Hauptzugänge zur Orchestra (aditus maximi) in den römischen Theatern der Schweiz. In: D. Fellague/J.-Ch. Moretti (éd.); Les théâtres antiques et leurs entrées. Parodos et aditus. Archéologie(s) 11 (Lyon 2024) 329-351.
Spécialiste de l’âge du fer et du mobilier métallique, Matthieu Demierre est professeur assistant l’Université de Lausanne. Il y enseigne l’archéologie de construction à l’époque protohistorique et Il dirige le chantier-école de Vidy-Boulodrome. Ses recherches combinent étude des vestiges et du mobilier pour une caractérisation fonctionnelle des espaces antiques. Sa thèse portant sur les assemblages métalliques de l’oppidum de Corent a été récompensée par le prix Gilbert Kaenel en 2021.
Mines, caves et remparts : quelques attestations d’escaliers protohistoriques européens
Cette communication proposera un bilan des principales occurrences d’escalier durant la protohistoire, principalement durant l’âge du Bronze et l’âge du Fer. Elle se focalisera dans un premier temps sur les espaces qui sont les plus propices à ce genre d’aménagement, à savoir le monde souterrain des mines et des structures de stockage, cave et celliers, qui reçoivent des installations en bois ou directement taillées dans le substrat. Nous essaierons ensuite de présenter quelques escaliers en élévation dans les rares structures de ces périodes qui soient conservées dans ces conditions, à savoir les fortifications.
Bibliographie sélective :
M. Demierre, Caractérisation des assemblages métalliques d’une agglomération celtique : le centre-ville de l’oppidum de Corent (Puy-de-Dôme, France), Protohistoire européenne 15, Série Oppidum de Corent 1, Mergoil, 2019, 2 vol.
M. Poux, M. Demierre, avec la collaboration de M. Garcia et de R. Lauranson et les contributions de J. Gasc, K. Gruel, F. Blondel, A. Michel, R. Guichon, P. Brand, H. Duchamp, A. Colombier, M. Loughton, A. Tripier, 484 p. et S. Foucras, P. Courtaud, É. Rousseau, A. Pranyies et F. Médard, Corent (Puy-de-Dôme, Auvergne), Le sanctuaire : vestiges et rituels, supplément Gallia 62, CNRS éditions, Paris, 2015.
P. Brand, M. Demierre, C. Ebnöther, J. Genechesi, A. F. Lanzicher, T. Luginbühl, D. Tretola Martinez, J. Reich, M. Raaflaub, J. Wimmer, « Chronologie et répartition spatiale des établissements fortifiés tardo-laténiens du Plateau et du Jura suisses », in : F. Delrieu, C. Féliu, Ph. Gruat, M.-C. Kurzaj et E. Nectoux (éd.), Les espaces fortifiés à l’âge du Fer en Europe, Actes du colloque AFEAF du Puy-en-Velay (30 mai-1er juin 2019), AFEAF 3, p. 375-391.
M. Demierre, G. Bataille, R. Perruche, « Faciès mobiliers et espaces rituels, Les ensembles des sanctuaires laténiens du IVe au Ier siècle av. J.-C. », in Ph. Barral, M. Thivet, Sanctuaires de l’âge du Fer. Actualités de la recherche en Europe celtique occidentale, Actes du colloque AFEAF de Dôle (25-28 mai 2017), AFEAF 1, 2019, p. 332-342.
Raphaël Vouilloz est un architecte suisse formé à l’EPFL. En 2021, il rejoint le laboratoire des Cultures Numériques du Projet Architectural (CNPA) du Prof. Bernard Cache comme assistant scientifique pour la recherche et l’enseignement en géométrie, stéréotomie et BIM (Building Information Modeling). Puis il entreprend un doctorat sous la direction de Philippe Marin, Prof. à l’ENSA Grenoble au laboratoire Méthodes et Histoire de l’Architecture (MHA), et co-encadré par Bernard Cache. Sa recherche porte sur l’étude géométrique de l’escalier en fer-à-cheval du Château de Fontainebleau, et la transposition des méthodes numériques de l’industrie à la stéréotomie.
L’escalier en fer-à-cheval de Fontainebleau ; étude géométrique et transposition numérique.
Construit en 1634 et attribué à Jean Androuet du Cerceau, l’escalier en fer-à-cheval du Château de Fontainebleau est un ouvrage remarquable de la stéréotomie, l’art des assemblages en pierre de taille.. Nos travaux l’abordent en deux temps. D’abord, par une étude géométrique sur la conception et la fabrication de sa voûte principale, du tracé de l’épure aux procédés de taille de la pierre. A partir de relevés numériques et de modélisation 3D paramétriques, et fondée sur des traités de stéréotomie qui émergent à la même époque, en variation d’un modèle traditionnel : la voûte d’arête en tour ronde et rampante. Celle-ci croise un arc rampant avec une vis de Saint-Gilles, un objet célébré pour sa complexité géométrique. Un tel mode d’invention est caractéristique de l’émergence de la figure de l’architecte. Dans un deuxième temps, nous utilisons le modèle numérique dans une série d’expérimentations visant à transposer les méthodes de conception-fabrication de l’industrie vers une pratique contemporaine de la stéréotomie. Intégrant BIM (Building Information Modeling) et modélisation paramétrique, ces procédés permettent d’intégrer la nature hétérogène du matériau pierre face à ses grands enjeux contemporains : la restauration du patrimoine et sa réintégration dans l’architecture contemporaine en vertu de ses qualités environnementales.
Bibliographie sélective :
Vouilloz, R. (2023). Étude des procédés de conception et de fabrication d’un ouvrage de stéréotomie à l’aide des outils numériques. Journée de la Recherche de l’ENSAG, Grenoble.
Vouilloz, R. (2024). Impacts des procédés numériques sur l’architecture en pierre de taille contemporaine. Synthèse d’entretiens. 36ème Congrès du Comité International de l’Histoire de l’Art, Lyon.
Vouilloz, R., & Marin, P. (2024). Modélisation BIM d’une famille variable de voussoir et de ses étapes de taille pour la vis Saint-Gilles. EduBIM 2024: Données, intelligences et nature de la ville durable, Paris.
Vouilloz, R., Percy, K., Arellano Risopatron, N., Liu, S., Marin, P., & Fai, S. (2024). Photomesh to Ifc Conversion for Overlay with 3d Tiles in an Open-Source Hbim Viewer (SSRN Scholarly Paper 4928595). Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=4928595
Edoardo Piccoli est professeur associé d’histoire de l’architecture au Politecnico di Torino. Membre du conseil scientifique du doctorat en architecture, histoire et projet (DASP), au Politecnico di Torino, il a été tuteur et co-tuteur de thèses de doctorat. Il est co-fondateur du CHG (Construction History Group) Politecnico di Torino-DAD, hôte de la 9e Conférence internationale d’histoire de la construction en 2027. Il est l’auteur de nombreux essais et il a édité plusieurs livres d’histoire de l’architecture de l’âge moderne et contemporaine et, plus récemment, sur l’histoire de la construction. Depuis 2015, il a été directeur d’études / enseignant invité à Suzhou (Xi’An Jiaotong-Liverpool University), Guangzhou (SCUT), Paris (EPHE), Milan (Politecnico, SSBAP). Il a participé en tant que consultant en histoire de l’architecture à des projets de restauration/transformation : Cavallerizza di Torino (2017-2025) ; Santa Chiara, à Turin (2016-2021) ; Cittadella di Alessandria (2017-2019) ; Borgo Castello alla Mandria (2019-2021) ; Palazzo Carignano (2021-22).
Des ascensions fragiles. Escaliers italiens en porte-à-faux en marbre entre XIXe et XXe siècle
La tâche de l’historien de la construction est parfois de se concentrer sur des sujets inhabituels et de diriger son attention sur l’évolution de dispositifs ou de composants spécifiques de la construction courante. L’escalier en pierre en porte-à-faux avec des marches encastrées dans le mur fait partie des systèmes constructifs les plus anciens. Cependant, nous en analyserons sa transformation en Italie entre le XIXe l’industrie extractive. Le résultat paradoxal est la métamorphose du marbre, matériau qui, mis en œuvre, devient, de résistant et coûteux, fragile et peu cher. L’histoire de l’escalier en porte-à-faux en marbre au XXe siècle – une histoire d’arrière-garde et de survie, par rapport à l’émergence des systèmes en béton armé – est ponctuée de créations spectaculaires, mais aussi d’effondrements ruineux.
Bibliographie sélective :
2024 (avec E. D’Orgeix), Il palazzo dell’Arsenale di Torino. Un progetto europeo, Genova, Sagep
2023 “Scale a sbalzo a tutt’alzata in uso in Piemonte nel Sei-Settecento” e “Scale a sbalzo in lastre di marmo a Torino nei primi decenni del Novecento” ”(avec Maurizio Gomez Serito, Giulio Ventura), in Scale e risalite nella Storia della Costruzione in età Moderna e Contemporanea, éd. Valentina Burgassi, Francesco Novelli, Alessandro Spila, Construction History Group – Politecnico di Torino, pp. 117-132 e 163-181 2022, “Uno dei plus excellents Bastiments de France nelle mani dei Savoia-Carignano-Soissons: il castello di Creil”, Quaderni dell’istituto di Storia dell’Architettura, vol. 75-76, pp. 119-134.
2021 (avec F. Favaro, R. Caterino), Vittone 250. L’atelier dell’Architetto, Numero monografico di «Archistor», Reggio Calabria, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
2021 (avec V. Burgassi, M. Volpiano), Quaderni di storia della costruzione, vol. 1. Storia della costruzione: percorsi politecnici, Politecnico di Torino.
2021, “Una storia applicata per l’architettura civile”, Aedificare. Revue internationale d’histoire de la construction, n°10, pp. 13-22
2020,”The Turin cornice”, GTA Papers, 6, pp. 51-59
2019 (avec C. Tocci), “A prova di bomba. Ingegneri, architetti e teorie sulle volte in un cantiere militare di metà Settecento”, Archistor VI, n. 12, pp. 212-251
2019 (avec C. Tocci), “Building on Water and the Modern State. Eighteenth Century foundation techniques in the fortifications of Alessandria”, in Water, Doors and Buildings. Proceedings of the Sixth Conference of the Construction History Society, Queens’ College, Cambridge 5-7 April 2019, pp. 358-376
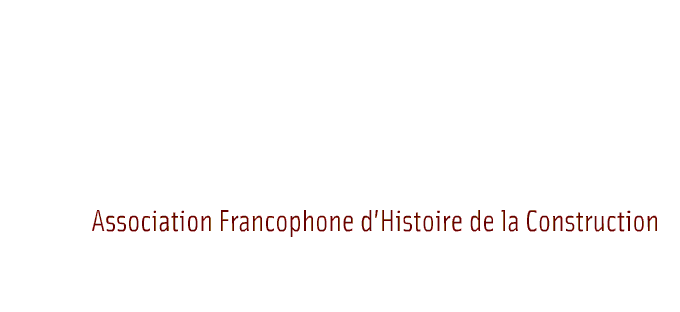
 Fondazione Querini Stampalia, Venise
Fondazione Querini Stampalia, Venise